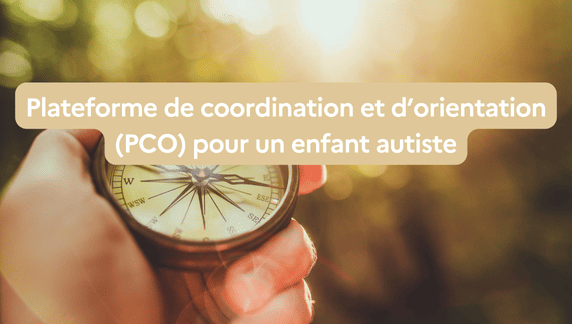Aller au collège quand on est un jeune avec autisme, TDAH, troubles dys, Tourette…
Sommaire
Aller au collège quand on est un élève autiste, TDAH, dys, Tourette…
L’arrivée au collège est un mode de fonctionnement bien différent de l’école primaire. Ces changements peuvent inquiéter l’élève avec concerné par un trouble du spectre de l’autisme ou un autre trouble du neurodéveloppement.
Comment anticiper cette étape importante et lui donner les moyens de s’épanouir ?
1. Comment se passe l’inscription d’un collégien avec TND ?
L’inscription se fait directement dans le collège de secteur.
Une dérogation peut être demandée au directeur académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) avant l’inscription, afin qu’il décide de la nouvelle affectation dans un collège plus en mesure de prendre en compte les besoins spécifiques d’un élève avec TND (trouble du neurodéveloppement).
Pour une scolarisation dans une école privée, il convient de contacter directement l’établissement.
Après l’inscription, un rendez-vous est pris avec le chef d’établissement pour évoquer la situation du jeune. A cette occasion, la famille peut transmettre les documents permettant de mieux connaître son fonctionnement :
- GEVAsco (Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation), qui regroupe les principales informations sur la scolarité et l’élève et sert à établir le Projet personnalisé de scolarisation (PPS) par la MDPH (maison départementale des personnes handicapées)
- PPS (projet personnalisé de scolarisation) en cas de handicap
- PAP (plan d’accompagnement personnalisé) en cas de troubles des apprentissages
- PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) en cas de difficultés scolaires
- PAI (projet d’accueil individualisé) en cas de pathologie chronique ou de particularités alimentaires qui nécessitent que la famille fournisse le repas
- livret de parcours inclusif, bilans de l’orthophoniste, du psychomotricien, de l’éducateur et du psychologue.
La famille est ensuite mise en relation avec l’équipe éducative et l’ERSEH (l’enseignant référent du secteur) qui suit la scolarité des élèves en situation de handicap.
Il est important que l’élève rencontre les équipes et puisse visiter le collège en veillant à bien identifier les lieux principaux et les personnes ressources, notamment le conseiller principal d’éducation (CPE) et l’assistant d’éducation (AED).
2. Quel est le rôle de l’équipe éducative ?
En principe sensibilisée et formée aux TND , elle a pour mission d’analyser les besoins et d’évaluer les compétences de l’élève pour lui offrir les meilleures conditions de scolarité.
Selon les besoins identifiés, elle élabore un projet pédagogique permettant les apprentissages.
Pour les élèves en situation de handicap, le Projet personnalisé de scolarisation (PPS) est rédigé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), pour prescrire divers aménagements pédagogiques, aussi bien des aides humaines que techniques.
3. Quels aménagements sont possibles pour collégien concerné par un TND (autisme, TDAH, dys, Tourette…) ?
Le collégien peut suivre un enseignement en classe ordinaire avec, si besoin, quelques aménagements :
- Un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) pour l’aider à organiser son travail, suivre les consignes, participer et prendre des notes. Cette aide peut être individualisée (si l’élève a besoin d’une attention soutenue et continue) ou mutualisée (l’AESH accompagne plusieurs élèves simultanément ou successivement).
- Du matériel pédagogique adapté, notamment informatique : ordinateur et tablette, clef USB, logiciels ou applications spécifiques, impression des productions… L’EMAP de l’établissement (Enseignant missionné pour l’accessibilité pédagogique) est en charge de ce volet. Les pôles d’appui à la scolarité (PAS) pourront également avoir cette mission sans nécessairement passer par la MDPH. (Renvoyer vers la page PAS évoquée dans la partie primaire)
4. Pourquoi une pédagogie adaptée est-elle préférable ?
L’enseignant qui accueille un collégien avec TSA ou TND doit prendre connaissance de ses particularités sensorielles et cognitives pour favoriser sa scolarisation. Quelques clés importantes :
- S’adapter au mode de communication de l’élève
- Structurer le temps de classe
- Verbaliser les attendus, les objectifs d’apprentissage de façon simple et mesurable
- Séquencer : favoriser une consigne à la fois, planifier les consignes…
- Personnaliser les objectifs : proposer des temps de pause, des temps de répit sensoriel (isolement dans un endroit calme…), permettre l’utilisation d’outil d’adaptation avant de rentrer dans une logique de compensation.
–> Pour aller plus loin : Collégiens avec TSA : comment favoriser la scolarisation ?
Une sensibilisation au trouble du spectre de l’autisme et aux autres troubles du neurodéveloppement (TDAH, troubles dys, Tourette…) peut être envisagée avec l’ensemble des élèves de la classe afin de développer la connaissance et la compréhension de ce trouble, permettant d’éclairer certains comportements atypiques.
Cette sensibilisation reste néanmoins très générale et il est recommandé de l’adapté aux profils des élèves concernés par un TND l’établissement.
5. Comment conjuguer la présence en classe avec les prises en charge médico-sociales ?
Le PPS tient également compte de l’articulation entre les temps d’enseignement, les temps périscolaires et les interventions psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales et de la répartition entre les différents lieux (établissement scolaire ordinaire, établissement et service médico-sociaux, domicile).
Une coopération étroite entre l’Éducation nationale et la sphère médico-sociale est à l’œuvre partout sur le territoire :
- Plus de 203 équipes mobiles d’appui à la scolarisation (Emas) contribuent à l’analyse des situations d’élèves dans les établissements scolaires.
- Les PIAL (pôle inclusif d’accompagnement localisé) renforcés et les PAS (pôle d’appui à la scolarité) en déploiement coordonnent les actions en direction des élèves à besoins éducatifs particuliers.
–> En savoir plus :
– sur les PIAL renforcés
– sur le PAS
6. Ulis, autorégulation, SEGPA, médico-social : quels sont les autres dispositifs ?
A. Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis)-collège.
Lorsque les exigences d’une scolarisation individuelle ne sont pas compatibles avec ses besoins spécifiques, le collégien peut, comme à l’école élémentaire, être scolarisé avec l’appui d’une Ulis.
Encadré par un enseignant spécialisé, il est scolarisé dans sa classe de référence, avec, en complément, des temps de travail en groupe restreint (10 élèves maximum au collège) pour les matières dans lesquelles il a des difficultés.
C’est la MDPH qui notifie l’orientation en Ulis-collège dans le cadre du PPS. A la rentrée 2024, on en recense 180 en France.
À la fin du collège, les jeunes peuvent être orientés en Erea (établissement régional d’enseignement adapté) ou LEA (lycée d’enseignement adapté), en Ulis pro au sein d’un lycée professionnel ou Ulis dans un lycée général et technologique, en établissement médico-social ou CFA (centre de formation d’apprentis), pour permettre un choix plus étendu de formations professionnelles.
B. Autorégulation
Il s’agit d’un dispositif scolaire qui s’applique à l’ensemble des élèves mais aussi aux enseignants favorisant ainsi les réussites et l’estime de soi.
Il vise, notamment, à favoriser l’inclusion l’intégration des élèves présentant un TND dans les classes ordinaires publiques, en leur apprenant à maîtriser leurs émotions et leurs comportements, à devenir plus autonomes et à gagner en confiance dans les apprentissages.
Quand il en ressent le besoin, le collégien retourne vers un espace spécifique destiné à l’autorégulation, pour des accompagnements ponctuels et individualisés avec des éducateurs spécialisés ou d’autres professionnels du médico-social (psychologue, rééducateurs…).
Cette équipe aide également les enseignants à rendre leur pédagogie accessible à tous.
C. Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)
En cas de troubles d’apprentissage sévères, les enseignements de ce dispositif débouchent en général sur une inscription en lycée professionnel ou centre de formation des apprentis (CFA).
–> En savoir plus sur les classes Segpa
D. Scolarisation en établissement médico-social
Lorsque les circonstances l’exigent, le collégien en situation de handicap peut être orienté vers l’unité d’enseignement d’un établissement ou service médico-social :
- instituts médico-éducatifs (IME),
- instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)…
L’élève bénéficie d’un PIA (Projet individualisé d’accompagnement), projet global qui intègre les composantes pédagogique , éducative et thérapeutique lorsque cela est possible.
Ces établissements offrent une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique adaptée par une équipe pluridisciplinaire avec des modalités d’accueil variées (externat, semi-internat, temps partagé avec le milieu ordinaire, placement familial…).
7. Quels aménagements d’épreuves lors des examens de fin de 3e ?
En fin de troisième, comme pour le baccalauréat et tout autre examen officiel, des aménagements d’examens peuvent être accordés pour passer le diplôme national du brevet (DNB) mais aussi les certifications et attestations (DNB professionnel, CFG, ASSR, PIX, Evalangue…) auxquelles prépare le collège. Par exemple :
- tiers-temps supplémentaire
- adaptation d’épreuve
- aide d’un preneur de notes ou l’assistance de son AESH
- autorisation d’utiliser des matériels ou logiciels adaptés utilisés durant sa scolarité
- la possibilité de composer dans une salle à part pour optimiser la concentration.
Pour bénéficier de ces aménagements, validés par le recteur de l’académie, il convient de renseigner un dossier, complété par l’avis du médecin scolaire ou un médecin désigné par la MDPH.
Chaque académie publie dès l’automne le calendrier à respecter pour ces procédures.
A noter que l’obtention du brevet n’est pas nécessaire pour passer en 2nde (générale, technologique ou professionnelle) ou en certificat d’aptitude professionnelle (CAP).
–> Toutes les précisions sont à retrouver dans cette circulaire.
Pour en savoir plus :
- Numéro vert École inclusive
- Éduscol : collège
- Scolarité des élèves en situation de handicap
- Diplôme national du brevet
À retenir
L’inscription d’un collégien avec TND se fait directement dans le collège de secteur mais une dérogation peut être demandée pour un autre établissement plus adapté.
- Le Projet personnalisé de scolarisation (PPS), rédigé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), prescrit divers aménagements pédagogiques, aussi bien des aides humaines (AESH) que techniques (ordinateur, logiciels…).
- En fin de troisième, pour le passage du diplôme national du brevet (DNB), des aménagements d’examens peuvent être accordés.
- Des alternatives existent pour les collégiens ayant des difficultés à suivre une scolarité à temps plein en classe ordinaire.
- Une coopération étroite avec le médico-social est à l’œuvre pour permettre à ses professionnels d’accompagner le collégien sur son lieu d’étude.
À savoir
Les dispositifs et aménagements présentés dans cette fiche s’inscrivent pleinement dans les objectifs de la Stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027, qui vise à renforcer l’inclusion scolaire et la continuité des parcours des enfants, adolescents et jeunes adultes avec TND.
Cette stratégie prévoit notamment :
- l’amélioration de l’accompagnement scolaire, grâce à une meilleure identification des besoins, la diffusion d’outils adaptés et la formation des professionnels de l’Éducation nationale ;
- le développement de dispositifs inclusifs, tels que les ULIS, les dispositifs d’autorégulation ou les services médico-sociaux intervenant en milieu ordinaire ;
- la sécurisation des transitions éducatives, notamment entre le collège, le lycée et l’enseignement supérieur ou professionnel ;
- la montée en compétence des équipes pédagogiques et médico-sociales, afin de garantir un environnement scolaire accessible, structuré et adapté aux profils cognitifs et sensoriels des élèves avec TND ;
- le renforcement de la coopération entre les acteurs de l’école et du médico-social, pour assurer un suivi coordonné et adapté tout au long de la scolarité.
- Sante.gouv.fr : Définition, fonctionnement & différentes formes de l’autisme
- Handicap.gouv.fr – Les troubles du neurodéveloppement
- Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux communément appelé DSM (publié en 2013, disponible en français depuis 2015 dans sa cinquième version : DSM-5), section « Troubles neurodéveloppementaux »
- Classification Internationale des Maladies 11e révision (CIM-11) entrée en vigueur en 2022, section « Troubles neurodéveloppementaux »