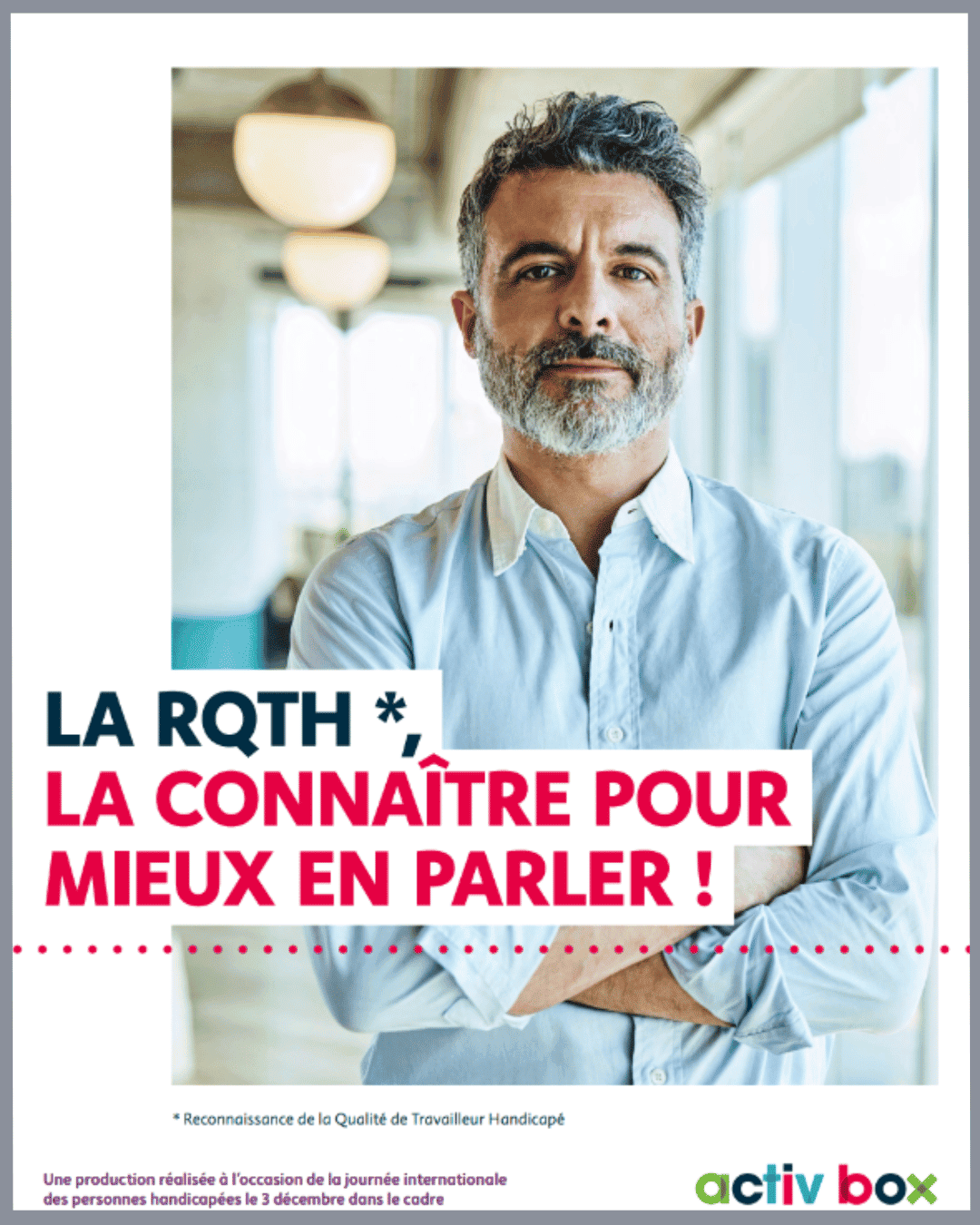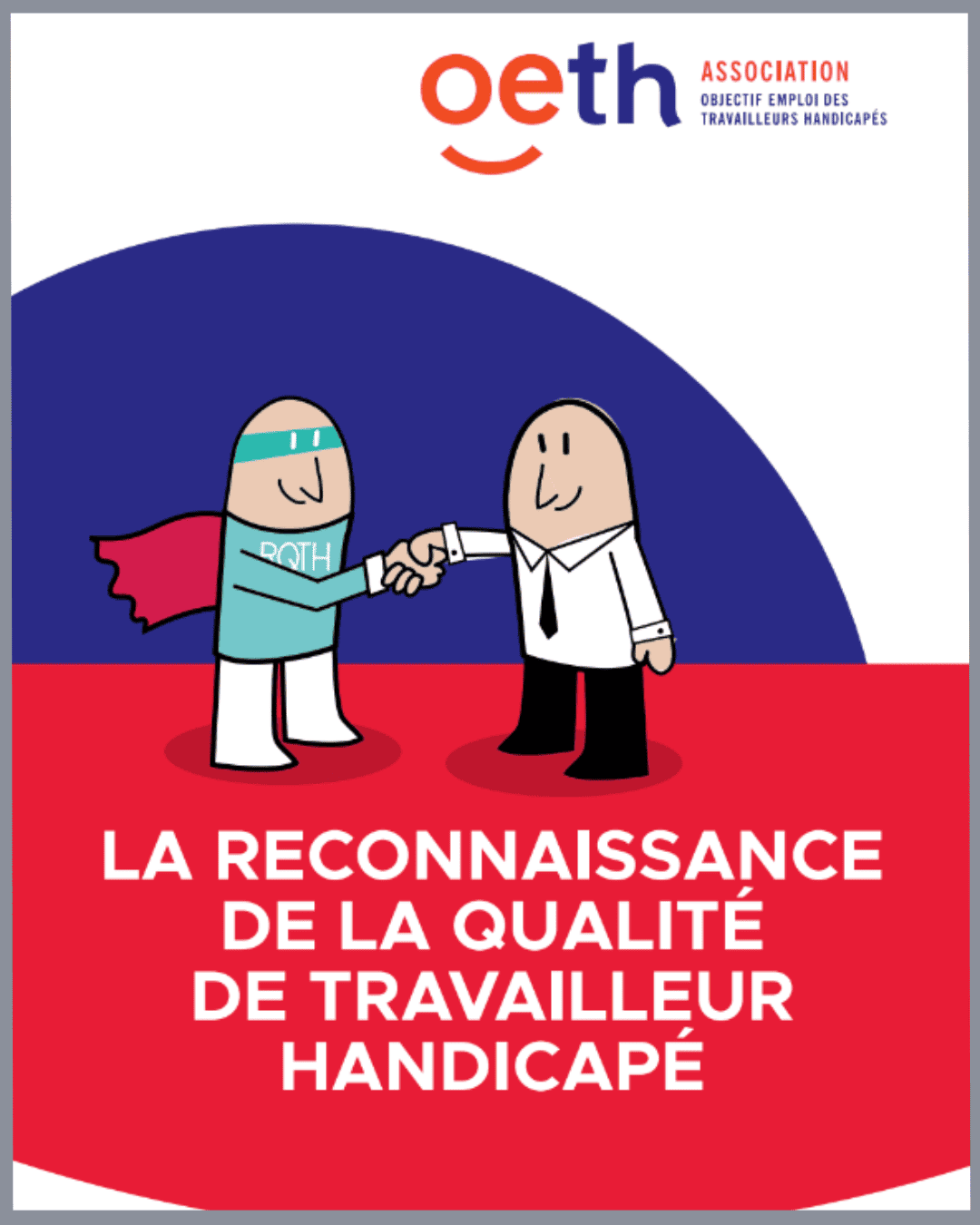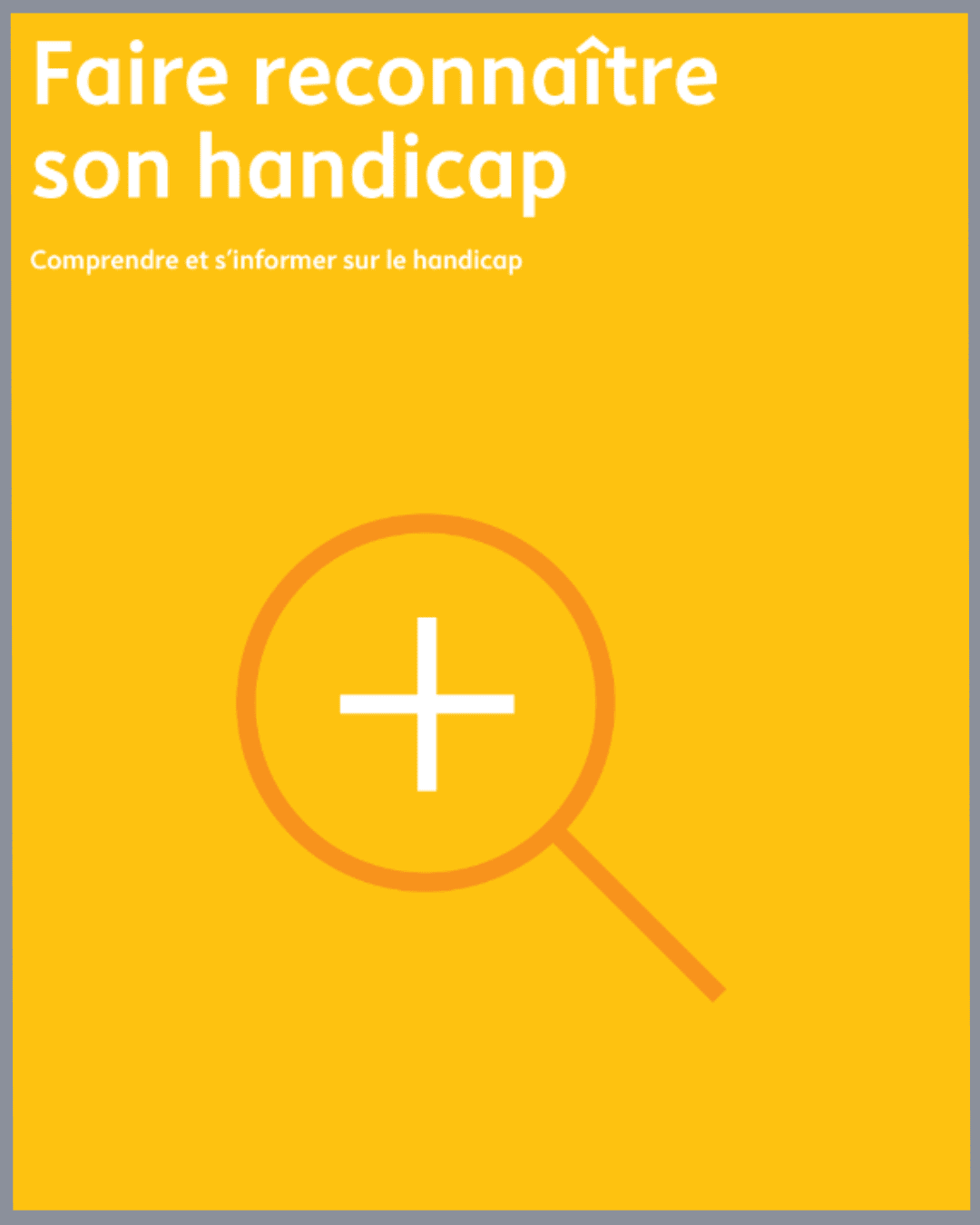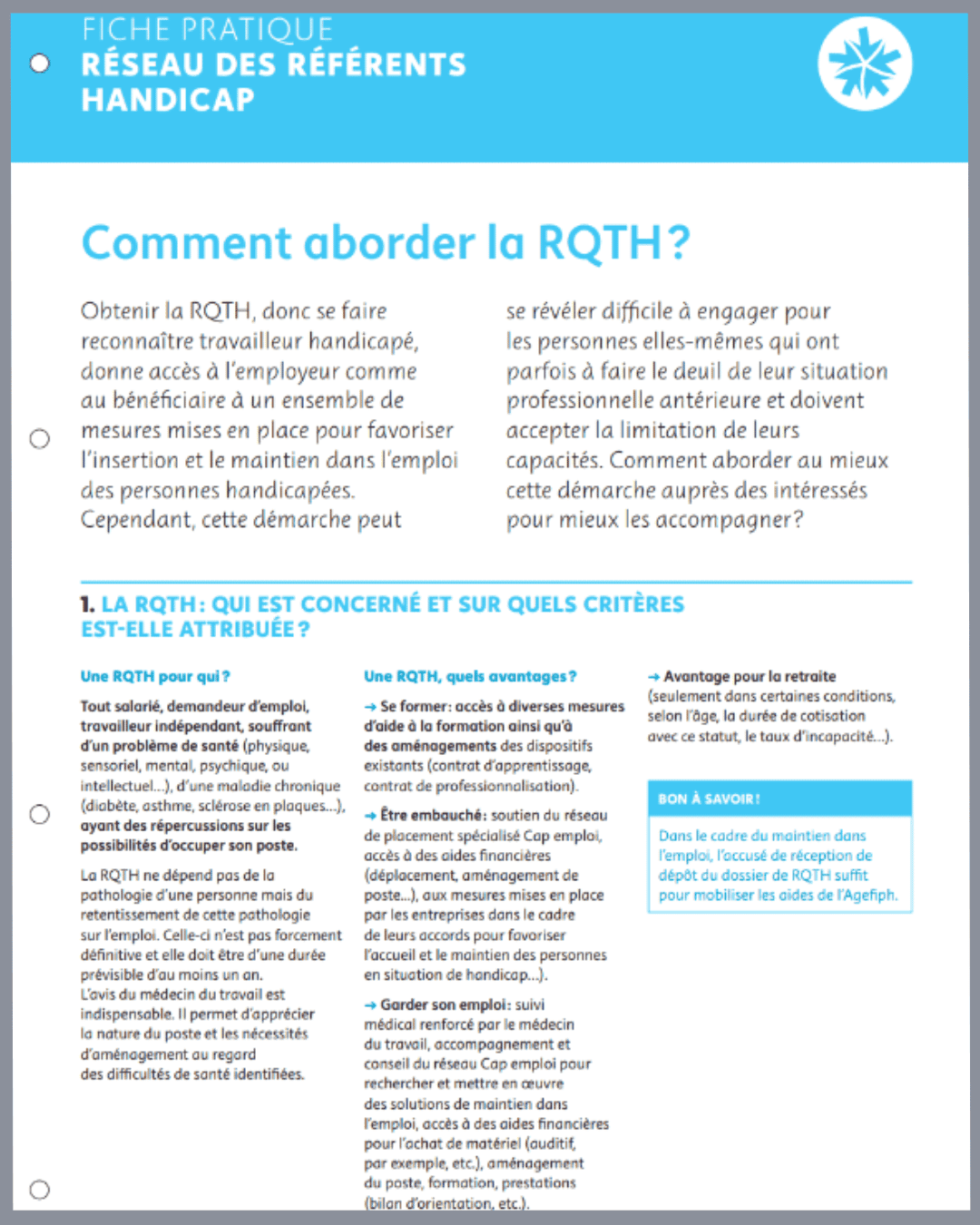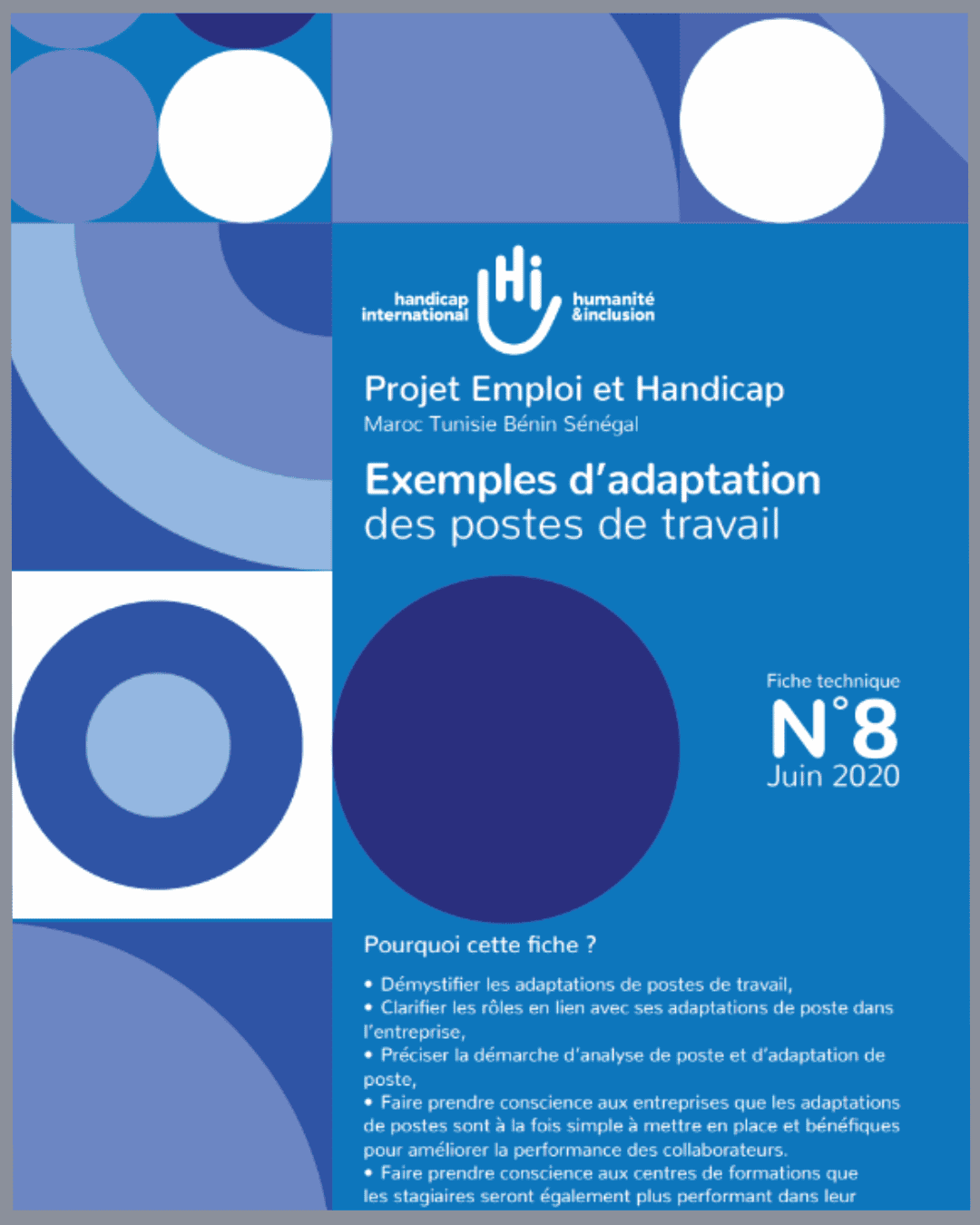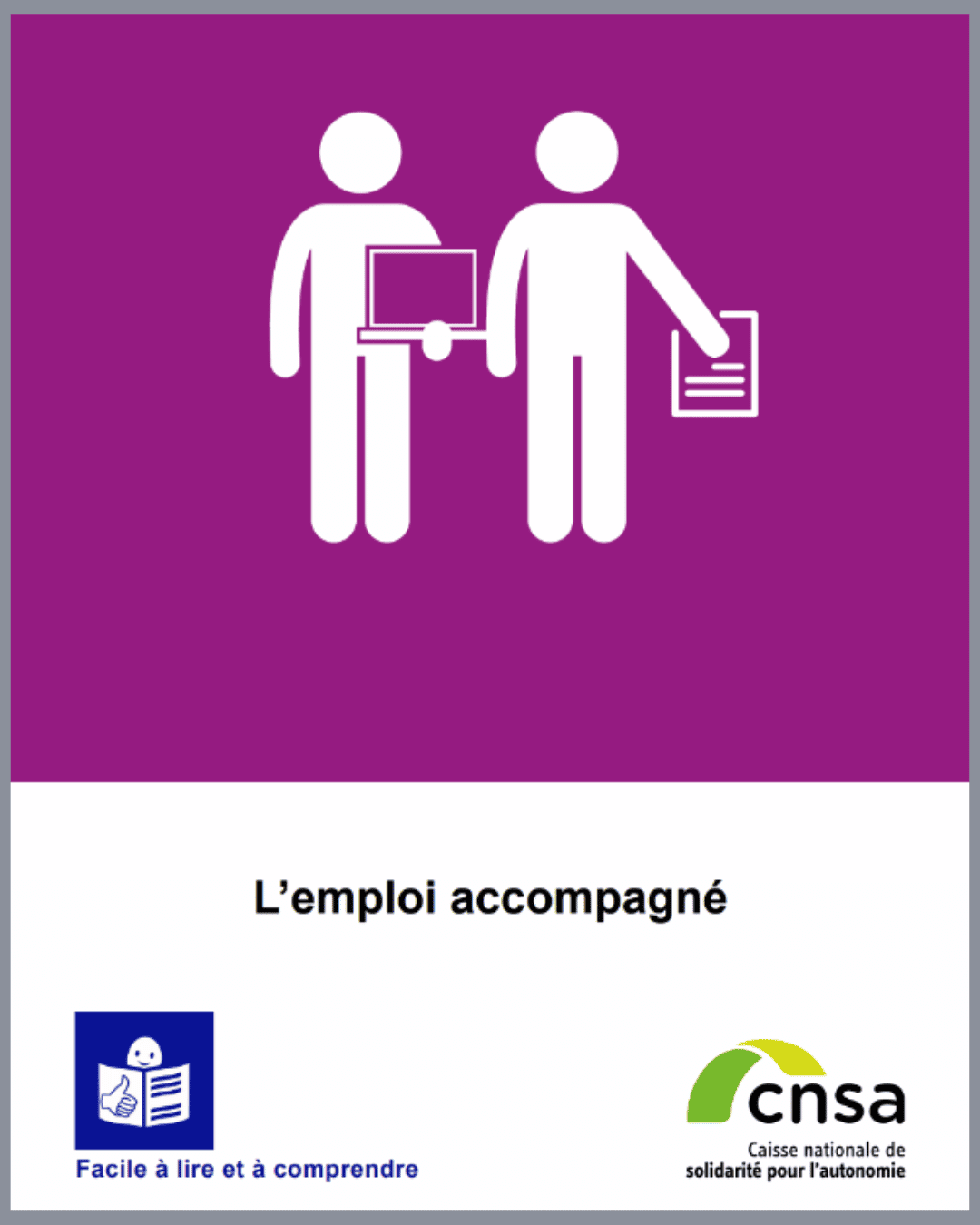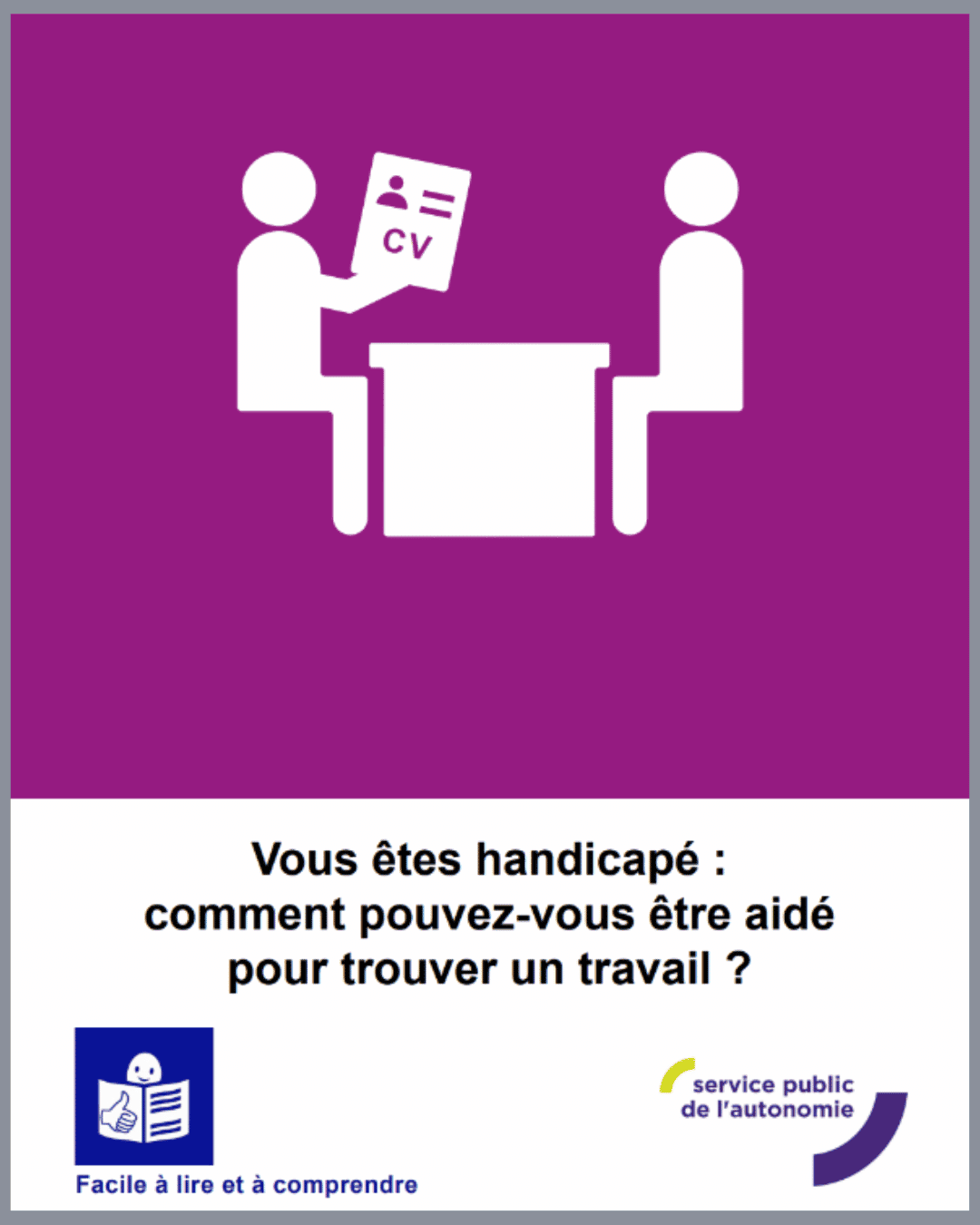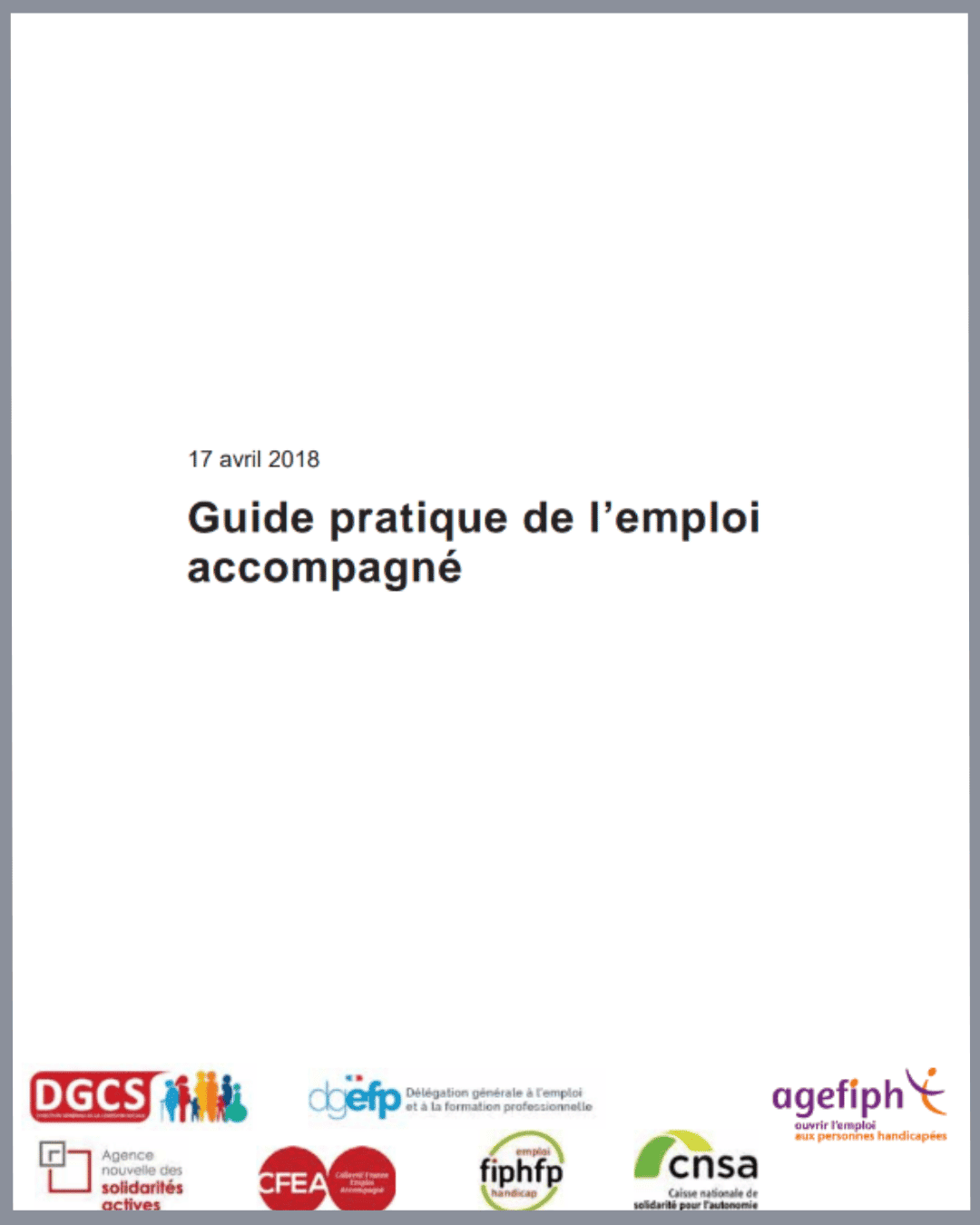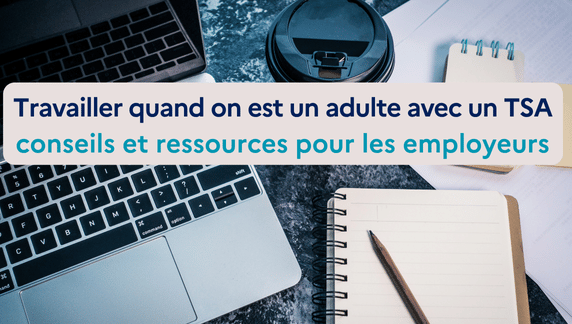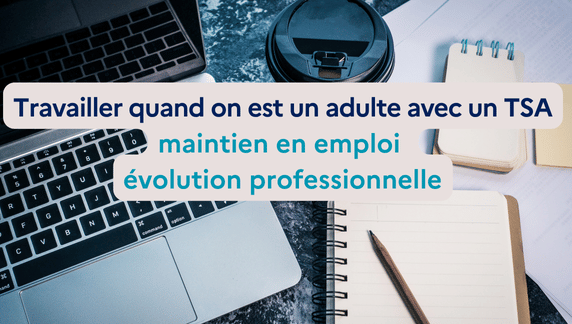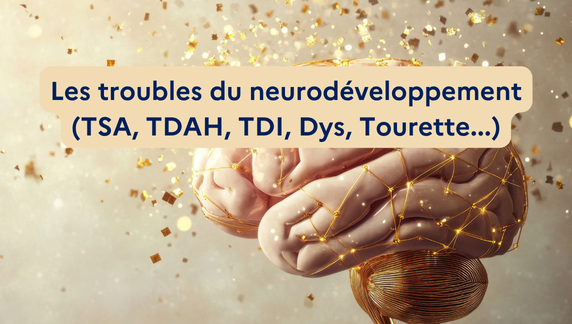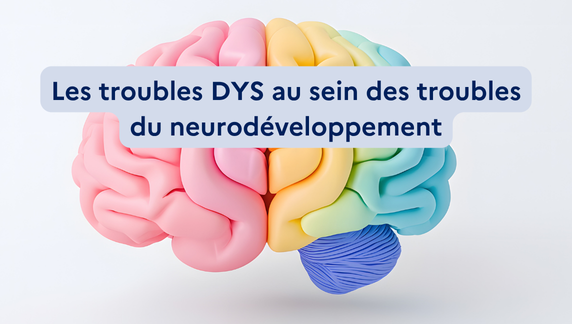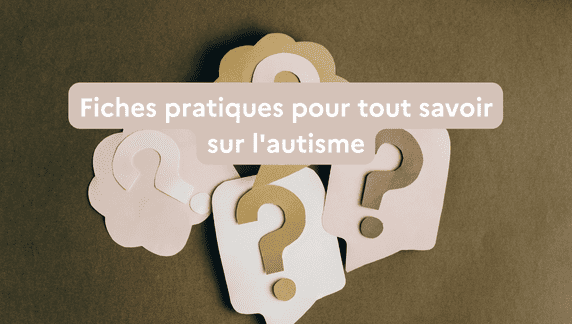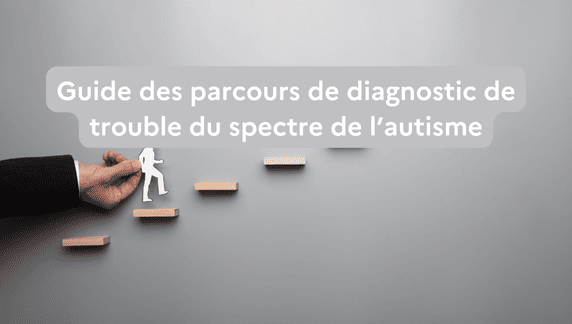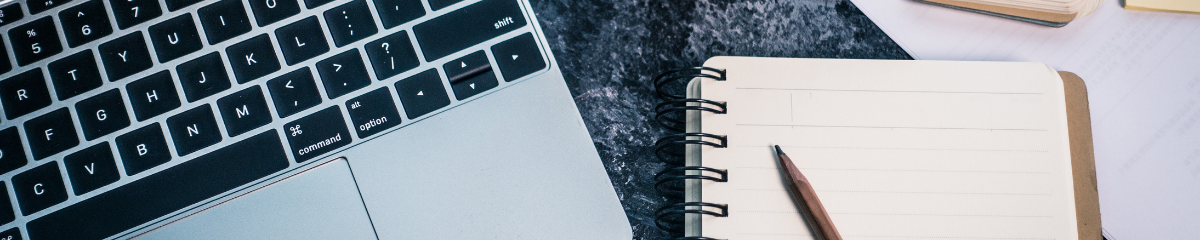
Travailler quand on est une personne autiste – aides et droits
Sommaire
Travailler quand on est une personne autiste – droits et aides
L’accès à l’emploi représente un enjeu majeur pour les personnes autistes ou un autre trouble du neurodéveloppement. Travailler, c’est pouvoir développer son autonomie, participer à la vie sociale, valoriser ses compétences et bénéficier d’un revenu.
Pourtant, le taux d’emploi des personnes autistes reste faible en France, notamment dans le milieu ordinaire. Cette situation s’explique par plusieurs facteurs : obstacles dans les processus de recrutement, méconnaissance des besoins spécifiques, manque d’aménagements adaptés et persistance de stéréotypes.
Retrouvez dans cette fiche pratique les différentes étapes du parcours professionnel : préparation, orientation, intégration, maintien dans l’emploi, dispositifs de soutien et ressources disponibles.
I. Comprendre les spécificités de l’autisme en contexte professionnel
Le trouble du spectre de l’autisme se caractérise par une grande diversité de profils. Chaque personne présente des compétences et des besoins spécifiques qui doivent être pris en compte individuellement.
De nombreuses personnes autistes disposent de forces précieuses en entreprise : rigueur, mémoire, sens du détail, logique, pensée analytique ou créativité. Ces qualités sont souvent très recherchées dans des secteurs variés (informatique, qualité, recherche, logistique, comptabilité, métiers artistiques…). Contrairement aux idées reçues, les personnes autistes peuvent occuper tout type de métier !
Certaines difficultés peuvent toutefois impacter la vie professionnelle :
- communication sociale (implicite, ironie, langage non verbal) ;
- hypersensibilités sensorielles (bruits, lumière, odeurs) ;
- stress face à l’imprévu ou à la surcharge d’informations ;
- difficultés à gérer les interactions multiples ou les changements rapides.
Ces particularités ne sont pas des freins, mais nécessitent une meilleure compréhension et la mise en place d’aménagements individualisés.
II. Avant de postuler / préparer son projet professionnel
Bien préparer son projet professionnel est essentiel. Cela permet de mieux cibler les postes, d’anticiper les besoins et d’accéder aux dispositifs de soutien existants.
1. Faire le point sur ses compétences et besoins
Un accompagnement personnalisé (bilan de compétences, job coaching, appui de Cap Emploi ou d’un CRA) aide à identifier les forces, les contraintes et les conditions de travail favorables.
2. Explorer les environnements professionnels possibles
Il existe deux grands cadres d’emploi (voir la section « IV. Les différents environnements de travail » ci-dessous :
- le milieu ordinaire de travail, qui correspond à l’ensemble des entreprises classiques, publiques ou privées ;
- le secteur protégé ou adapté, qui regroupe les ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail) et les EA (Entreprises Adaptées).
Ces environnements répondent à des besoins et à des degrés d’autonomie professionnelle différents (voir section suivante).
3. Formation et alternance
Les formations professionnelles, l’apprentissage et les stages sont des étapes importantes pour découvrir un métier, acquérir des compétences et tester un environnement de travail.
III. Reconnaissance du handicap en milieu professionnel et dispositifs accessibles
1. Qu’est-ce que la RQTH ?
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est attribuée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), après examen d’un dossier déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Elle permet de faire reconnaître officiellement la situation de handicap dans le cadre professionnel et d’ouvrir des droits spécifiques.
La RQTH facilite notamment :
- la mise en place d’aménagements de poste adaptés ;
- l’accès à des aides financières, techniques ou humaines ;
- l’accompagnement par des structures spécialisées comme Cap Emploi ;
- l’accès au dispositif d’emploi accompagné ;
- l’orientation, si besoin, vers le milieu ordinaire, une entreprise adaptée (EA) ou un établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
La RQTH est un outil au service du parcours professionnel. Elle vise à sécuriser et à adapter l’emploi, et non à restreindre les possibilités d’embauche.
Informer son employeur n’est pas obligatoire.
La personne reste libre de partager ou non cette information. Cependant, en pratique, en parler peut faciliter la mise en place d’aménagements raisonnables et permettre au référent handicap ou à la médecine du travail de mieux accompagner le salarié.
2. Comment faire la demande de RQTH ?
La demande de RQTH se fait auprès de la MDPH du lieu de résidence.
Le dossier comprend :
- un formulaire administratif (Cerfa) ;
- un certificat médical récent (moins de 12 mois) ;
- des pièces justificatives d’identité et de domicile.
Une fois le dossier complet, la MDPH l’instruit puis le soumet à la CDAPH, qui prend la décision d’attribution.
La notification précise la durée de validité de la RQTH (souvent 1 à 5 ans, parfois à titre définitif) et, le cas échéant, une orientation professionnelle (milieu ordinaire, EA, ESAT) ou la prescription d’un emploi accompagné.
À noter : lors d’une première demande ou d’un renouvellement d’AAH, la demande de RQTH peut être formulée en parallèle.
Voici quelques ressources pour comprendre la RQTH :
3. Que sont les aménagements raisonnables du poste de travail ?
Tout employeur a l’obligation de mettre en place des mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé d’accéder à un emploi, de le conserver et d’y progresser.
Ces mesures sont appelées « aménagements raisonnables ». Elles visent à compenser les effets du handicap sur le poste sans bouleverser l’organisation de l’entreprise.
Exemples d’aménagements possibles (à adapter en fonction de la situation et des besoins du salarié concerné) :
- adaptation de l’environnement (bruit, lumière, poste isolé, matériel spécifique),
- ajustement de l’organisation du travail (horaires, pauses, télétravail),
- clarification de la communication (consignes écrites, supports visuels, planification claire),
- mise en place d’un tutorat ou d’un accompagnement renforcé.
La médecine du travail peut proposer des préconisations lors d’une visite d’information, de reprise ou de pré-reprise, afin d’aider l’employeur à définir les adaptations nécessaires.
Voici quelques ressources pour en savoir plus :
4. Quels sont les principaux acteurs de l’accompagnement en emploi ?
Plusieurs interlocuteurs peuvent être sollicités pour faciliter l’accès ou le maintien dans l’emploi :
- Cap Emploi : accompagne les personnes handicapées dans la recherche d’emploi, la mise en place d’aménagements et le maintien en poste.
- Le référent handicap et les ressources humaines : assurent la coordination interne et le suivi des adaptations.
- La médecine du travail : évalue les conditions de travail et formule des préconisations.
- Les Centres Ressources Autisme (CRA) : apportent information, conseils et sensibilisation sur l’autisme et les besoins spécifiques en milieu professionnel.
- Le dispositif d’emploi accompagné : assure un soutien durable au salarié et à l’employeur.
Voici quelques ressources pour en savoir plus :
5. Quelles sont les aides financières et techniques pour aménager le poste de travail ?
Des aides existent pour compenser les surcoûts liés à l’aménagement d’un poste ou à la mise en place d’un accompagnement. Elles diffèrent selon le secteur d’activité.
Dans le secteur privé
L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) finance tout ou partie du coût des adaptations :
- aménagement du poste (mobilier, matériel, outils numériques, signalétique, logiciels spécifiques) ;
- aides humaines (interprète, interface de communication, accompagnement externe, job coach) ;
- accompagnement et formation (diagnostic de situation, sensibilisation des équipes, mobilité, formation professionnelle).
L’Agefiph intervient généralement sur le surcoût lié au handicap, c’est-à-dire la différence entre une solution standard et une solution adaptée.
Dans la fonction publique
Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) propose des dispositifs équivalents :
- adaptation du poste et de l’environnement de travail ;
- accompagnement ergonomique et études de situation ;
- interventions de spécialistes du handicap ;
- formations et sensibilisations des équipes et encadrants.
Ces aides visent à garantir des conditions de travail équitables et inclusives.
- La RQTH n’est pas une étiquette mais un outil pour sécuriser le parcours professionnel.
- Elle ouvre des droits à l’accompagnement, aux aménagements et aux aides financières.
- La demande se fait auprès de la MDPH, sans obligation d’en informer l’employeur.
- Les aménagements raisonnables sont un droit et doivent être adaptés à chaque situation.
- De nombreux acteurs peuvent accompagner la démarche : Cap Emploi, référent handicap, CRA, emploi accompagné, Agefiph ou FIPHFP.
IV. Quelle est la différence entre le milieu ordinaire et le secteur protégé ?
1. Le milieu ordinaire
C’est l’ensemble des entreprises, publiques ou privées, où les salariés travaillent dans les mêmes conditions que les autres, avec éventuellement des aménagements ou un accompagnement spécifique (référent handicap, job coach, tutorat, etc.).
L’objectif est de permettre à chacun d’exercer un métier dans un cadre inclusif.
2. Le secteur protégé ou adapté
Ces dispositifs permettent de sécuriser les parcours professionnels et d’adapter le niveau d’encadrement selon les besoins de la personne.
- Les ESAT (Établissements et Services d’Accompagnement par le Travail) accueillent des personnes en situation de handicap ne pouvant pas, momentanément ou durablement, travailler dans le milieu ordinaire.
- Ils proposent une activité professionnelle à temps partiel ou complet, assortie d’un accompagnement médico-social.
- L’admission en ESAT se fait sur décision de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), après demande auprès de la MDPH.
- Les travailleurs d’ESAT relèvent du statut d’usager, et non du code du travail.
- Les Entreprises Adaptées (EA) sont des entreprises classiques, mais employant au moins 55 % de salariés reconnus handicapés.
- Les salariés d’EA relèvent du droit commun du travail.
- Ces structures offrent un cadre intermédiaire, plus souple et accompagné que le milieu ordinaire, mais plus proche du fonctionnement économique d’une entreprise classique.
V. Bon à savoir : AAH et emploi
L’AAH (aide à l’adulte handicapé) vise à garantir un revenu minimal aux personnes handicapées de plus de 20 ans (ou 16 ans si elles ne sont plus à charge).
Elle est attribuée selon :
- le taux d’incapacité (au moins 80 %, ou entre 50 % et 79 % si restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi) ;
- les ressources du bénéficiaire.
L’AAH est compatible avec une activité professionnelle, qu’elle soit exercée en milieu ordinaire, en ESAT ou en entreprise adaptée.
Son montant est alors partiellement réduit en fonction des revenus perçus, selon un barème établi par la CAF.
Cette articulation entre emploi et AAH permet de favoriser la reprise d’activité tout en sécurisant le parcours de la personne.
Parcourez les fiches pratiques en lien avec ce thème
Ces contenus pourraient vous intéresser
La Stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement (trouble du spectre de l’autisme, troubles Dys, trouble du développement intellectuel) fixe un cadre ambitieux pour améliorer le repérage, l’accompagnement et l’inclusion des personnes concernées.
Certaines des 81 mesures concernent directement l’emploi :
- Mesure 62 : « Poursuivre le développement de l’emploi accompagné »
- Mesure 63 : « Rendre possible l’emploi des personnes TSA et TDI accompagnées en MAS et FAM qui souhaitent travailler (…) avec l’appui de services experts et accompagner les entreprises prêtes à les recruter ».
- Mesure 64 : « Professionnaliser et outiller les acteurs en charge de l’accompagnement à l’emploi et les entreprises en lien avec France Travail ».
- Mesure 65 : « Valoriser et faire connaître les compétences des personnes TSA, DYS, TDAH, TDI ».
Ressources pour aller plus loin
- Cap Emploi
- Liste des Centres Ressources Autisme
- Mon Parcours Handicap, page Emploi, et plus particulièrement :
- La RQTH
- Esat : Établissement et service d’accompagnement par le travail
- Travailler dans une entreprise adaptée (EA)
- Les passerelles vers le milieu ordinaire
- Annuaire pour trouver votre conseiller France Travail, Cap emploi ou mission locale de votre département
- MDPH
- CDAPH
- AGEFIPH
- FIPHFP
- ConseilTND : de nombreuses ressources à télécharger pour les salariés concernés et pour les employeurs
- Participate !
- Mon entreprise inclusive : Comment accueillir les personnes autistes en entreprise ?
- France Travail : Dispositif Autisme et Emploi : Accompagner les personnes autistes dans l’insertion professionnelle