
Accéder aux études supérieures quand on est une personne autiste ou avec TND
Sommaire
Accéder à l’enseignement supérieur quand on est un jeune avec un trouble du neurodéveloppement (autisme, TDAH, trouble dys, Tourette…)
Cette fiche pratique présente les dispositifs d’accompagnement, les aménagements et les ressources utiles pour les étudiants autistes dans l’enseignement supérieur.
1. Études supérieures : quels enjeux ?
Pour réussir dans l’enseignement supérieur, un étudiant concerné par un trouble du neurodéveloppement (autisme, TDAH, trouble dys, Tourette…) peut avoir besoin d’un accompagnement adapté, que ce soit pour les études, l’organisation, la vie étudiante ou la préparation de l’insertion professionnelle.
La diversité des besoins doit être prise en compte : autonomie, gestion de l’énergie, compréhension des consignes, vie sociale, repérage dans les nouveaux environnements.
Identifier les ressources, connaître ses droits et s’appuyer sur des interlocuteurs spécialisés permet d’acquérir plus d’autonomie et de confiance.
2. Comment s’inscrire en études supérieures ?
S’inscrire sur Parcoursup
Le lycéen doit obligatoirement s’inscrire sur la plateforme Parcoursup que gère le ministère de l’Enseignement supérieur.
En fonction de ses souhaits et de ses résultats scolaires, le lycéen choisira :
- les formations,
- les établissements,
- le type de cursus (ex. BTS, DUT, école d’ingénieurs).
Il peut émettre 10 vœux maximum.
Le futur étudiant crée un dossier sur Parcoursup (avec un identifiant et un mot de passe) et exprime ses vœux. C’est sur cette plateforme que les établissements d’enseignement supérieur traitent les notes et les choix motivés des élèves.
Ces derniers acceptent ou déclinent les propositions reçues par la suite. Les réponses reçues peuvent être les suivantes :
- Oui : si l’établissement retient sa candidature,
- Oui, si : à condition de suivre une remise à niveau,
- Non : si l’établissement refuse sa candidature,
- Sur liste d’attente : sous réserve d’un désistement.
Certaines grandes écoles ne sont pas référencées par Parcoursup et font passer un concours d’entrée. Le lycée doit alors bien se préparer en restant vigilant au calendrier de l’établissement et la session.
Très important si le lycéen a déjà une reconnaissance de handicap (dossier MDPH)
Le lycéen a la possibilité de compléter une fiche de liaison dans Parcoursup. Il y expliquera en détail sa situation et ses besoins dans son futur parcours étudiant. Seul l’établissement ayant donné un avis favorable à sa candidature peut le consulter, donc avant sa rentrée. Ceci garantit que le handicap ne sera pas pris en compte dans le processus d’attribution des places. Cela vaut pour les universités aussi bien que les grandes écoles.
En l’absence d’avis favorable
Si ce cas ce produit, une commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) est mise en place. La CAES étudie le dossier. Elle accompagne le bachelier dans la recherche d’une école ou d’une université :
- aussi conforme que possible à ses vœux,
- et en mesure de l’accompagner.
Références :
–> Téléchargez le calendrier Parcoursup 2026.
- Parcoursup
- Parcoursup au service des candidats en situation de handicap
- Dispositifs pour accompagner les candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant
- Études supérieures : première inscription d’un étudiant
- Inscription dans l’enseignement supérieur
Découvrir les étapes à suivre pour s’inscrire à Parcoursup en 2026 :
3. Accompagnement dans les établissements d’enseignement supérieur
A. Le schéma directeur du handicap
Chaque établissement dispose d’un schéma directeur du handicap, mis en œuvre par un service ou une mission handicap. L’organisation et l’appellation peuvent varier.
B. Le Plan d’Accompagnement de l’Étudiant Handicapé (PAEH)
Le PAEH peut être mis en place, avec ou sans PPS. Il repose sur une évaluation menée avec :
- le référent handicap ;
- le médecin du service de santé universitaire ;
- l’étudiant ;
- les référents pédagogiques.
Les aménagements peuvent concerner :
- l’organisation du parcours universitaire ;
- les modalités d’évaluation ;
- la prise de notes ;
- du matériel ou des logiciels adaptés ;
- des aides humaines ;
- du tutorat ou du mentorat.
C. Le rôle du référent handicap
Il accompagne l’étudiant dans ses démarches, coordonne les échanges avec les équipes, organise les ajustements des aménagements et conseille sur la méthode de travail ou la gestion du stress.
D. La personne de confiance
L’étudiant peut désigner une personne de confiance (proche, professionnel) pour l’accompagner dans les échanges et les démarches.
4. Le programme Atypie-Friendly
A. Un programme national dédié aux étudiants avec TND
Atypie-Friendly est un programme qui vise à rendre l’université plus inclusive pour les étudiants avec autisme, troubles DYS ou TDAH. Porté par l’Université de Toulouse, il regroupe de nombreux établissements partenaires.
B. Inscription dans la Stratégie nationale pour les TND
La Stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027 identifie Atypie-Friendly comme un dispositif majeur pour améliorer l’inclusion dans l’enseignement supérieur.
Elle prévoit un financement et des actions dédiées pour renforcer cet accompagnement.
C. Fonctionnement dans les établissements partenaires
Les établissements signataires s’engagent à mettre en place une équipe locale Atypie-Friendly, en lien avec le service handicap. Cette équipe :
- accompagne l’analyse des besoins des étudiants ;
- aide aux démarches d’inscription et d’aménagements ;
- facilite les échanges avec les enseignants ;
- propose des outils et ressources méthodologiques.
D. Ce que propose Atypie-Friendly
- accompagnement personnalisé ;
- ateliers et outils méthodologiques ;
- webinaires et fiches pratiques ;
- espaces d’échange entre étudiants ;
- suivi pour les transitions (entrée à l’université, stages, insertion professionnelle).
E. Engagements liés à la charte Atypie-Friendly
Les établissements signataires s’engagent notamment à former les équipes, adapter les modalités pédagogiques et d’évaluation, faciliter la vie étudiante et proposer un accompagnement renforcé.
5. Aides humaines et médico-sociales
Certaines situations peuvent nécessiter l’intervention d’un SAMSAH ou d’un SAVS, en complément du service handicap. Ces services peuvent accompagner la vie quotidienne, l’autonomie ou les démarches administratives.
6. Organisation pédagogique et vie universitaire
A. Inscription pédagogique
-
Après l’inscription administrative, l’étudiant doit faire son inscription pédagogique : choix des cours, des semestres, des modalités d’évaluation.
-
Lors de cette inscription, le service de scolarité peut expliquer le fonctionnement du cursus, la validation des semestres, les règles d’évaluation.
B. Prise de notes
-
La prise de notes est souvent un défi : écouter, filtrer, sélectionner l’essentiel et noter tout cela demande beaucoup d’énergie.
-
Il est possible de s’entraîner avec des pairs : échanger ses notes avec d’autres étudiants peut aider à comprendre ce qui est important.
-
Si c’est très difficile : demander un preneur de notes via le service handicap. Ce soutien est rémunéré et peut être activé via le PAEH.
C. Travail en groupe
-
Les travaux de groupe peuvent être particulièrement exigeants (vitesse d’échange, communication rapide).
-
Il peut être utile d’expliquer ses difficultés aux coéquipiers : proposer des échanges par écrit, des réunions plus lentes ou travailler depuis un endroit calme (bibliothèque, chez soi).
-
Pour les doctorants : l’organisation est souvent plus autonome (séminaires, travail individuel) et permet une flexibilité dans la façon de s’organiser.
D. Vie étudiante
Participer à des activités de rentrée ou sensibiliser les pairs peut faciliter les interactions. Dire ou non qu’on est autiste est un choix personnel, mais cela peut aider à la mise en place d’aménagements.
E. Examens et évaluations
Les révisions écrites ou orales peuvent demander une méthodologie très structurée : planning, phases d’étude, techniques de mémorisation.
Les étudiants peuvent demander des aménagements d’examen auprès du service handicap ou de la mission handicap :
- temps supplémentaire
- adaptation des épreuves
- preneur de notes
- salle adaptée (isolée, calme)
Il faut faire ces demandes en amont (avant la rentrée ou plusieurs semaines à l’avance), car la mise en place peut prendre du temps.
7. Mobilité internationale (Erasmus+, échange)
-
Le programme Erasmus+ permet de partir étudier à l’étranger dans des universités partenaires.
-
Si des frais supplémentaires apparaissent en raison du handicap, il est possible de solliciter des aides (boursière, aides spécifiques, soutiens institutions).
-
Il peut être utile d’identifier à l’avance une personne référente dans l’établissement d’accueil à l’étranger : tuteur, étudiant, mentor, pour accompagner les démarches (cours, intégration, stress culturel).
8. Insertion professionnelle
Pour préparer l’avenir professionnel : les stages, l’alternance, les contacts avec des professionnels sont essentiels. (Le document mentionne l’importance de la préparation aux stages, bien que les détails concrets dépendent de la formation.)
Il peut être utile de préparer un document d’une page pour expliquer son autisme (traits, forces, difficultés) : à joindre à un CV ou à évoquer en entretien.
Il faut également anticiper la reconnaissance administrative : par exemple, renouveler ou activer une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), si pertinent, pour avoir des dispositifs de soutien à l’emploi.
À retenir
- Des dispositifs dédiés existent dans l’enseignement supérieur.
- Le PAEH est central pour formaliser les aménagements.
- Atypie-Friendly est un pilier majeur de l’inclusion des étudiants TND.
- De nombreuses aides pédagogiques, méthodologiques et humaines peuvent être mobilisées.
- L’anticipation et l’appui sur les interlocuteurs spécialisés renforcent les chances de réussite.
Découvrez les fiches en lien avec ce thème

Aller au lycée quand on a un TND
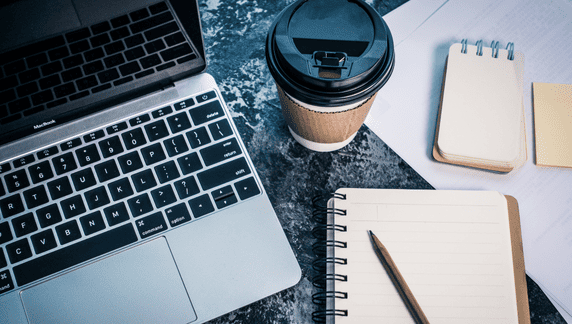
Travailler quand on est une personne autiste – aides et droits

Harcèlement scolaire contre les élèves avec TND

Aller au collège quand on a un TND

Dispositifs de scolarisation (ULIS, UEMA, UEEA…)


