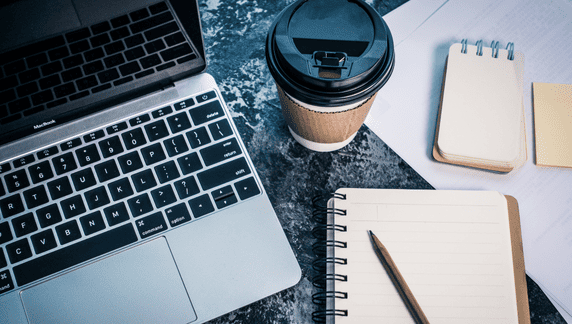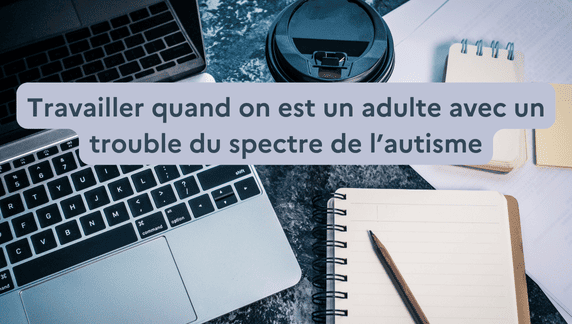Aller au lycée quand on est un jeune avec autisme, TDAH, troubles dys, Tourette…
Sommaire
Suivre sa scolarité au lycée quand on est un jeune autiste, TDAH, dys…
Le lycée constitue une étape cruciale pour l’élève avec TSA ou TND puisqu’il définit ses goûts et ses aptitudes et commence à tracer son parcours étudiant et professionnel. Quels sont les dispositifs existants pour lui permettre de poursuivre sa scolarité dans le respect de ses besoins ?
1. Le lycée général et technologique
Le lycée donne accès à 3 types d’enseignements :
-
un socle commun en culture commune, humaniste et scientifique ;
- en lycée général, des disciplines de spécialité choisies par l’élève (3 en classe de première, 2 en terminale) : géopolitique, humanités, mathématiques, sciences de l’ingénieur, biologie, sciences économiques et sociales, numérique et informatique, arts, culture sportive…
- en lycée technologique, des spécialités telles que management, agronomie, biochimie, arts appliqués, hôtellerie, sanitaire et social, développement durable ;
- un temps d’aide à l’orientation.
Le baccalauréat général ou technologique est noté de la façon suivante :
-
- Tout d’abord, un contrôle continu comptant pour 40 % de la note. Il comprend : l’enseignement de spécialité (1re), l’histoire-géographie, les sciences, les langues étrangères (A et B), l’enseignement moral et civique (1re et terminale), l’éducation physique et sportive (terminale).
- A cela s’ajoutent les enseignements optionnels des épreuves finales comptant pour 60 % de la note : 2 épreuves (écrite et orale) de français en 1re, 2 épreuves écrites en enseignement de spécialité, une épreuve de philosophie écrite et une épreuve orale de 20 minutes (essentielle pour la vie personnelle, sociale et professionnelle) sur la base d’un projet préparé.
A. Qui est concerné ?
Tous les lycéens présentant un trouble du neurodéveloppement (autisme, TDAH, dys, Tourette…), qu’ils soient :
- en lycée général, technologique ou professionnel ;
- avec ou sans notification de la MDPH ;
- en ULIS lycée, en dispositif d’accompagnement ou en inclusion individuelle.
B. Le rôle de l’équipe éducative
Les équipes pédagogiques et éducatives (professeurs, conseiller principal d’éducation, infirmiers, psychologues…) sont, en principe, sensibilisées aux TND et peuvent bénéficier de formations spécifiques. Elles travaillent en lien avec :
- l’enseignant référent du secteur ;
- le coordonnateur ULIS ;
- les AESH ;
- les partenaires médico-sociaux.
Un référent handicap est également désigné dans chaque lycée pour faciliter les démarches des familles.
C. Les aménagements scolaires
Pour faciliter la scolarité, l’accueil d’un lycéen avec TND repose sur des adaptations individualisées, humaines et techniques, notifiées par la CDAPH :
-
PPS (projet personnalisé de scolarisation) : élaboré avec l’Équipe de suivi de la scolarisation (ESS) et actualisé en fin de 3e pour assurer la continuité du parcours scolaire en tenant compte des décisions d’orientation du conseil de classe et en informant l’équipe éducative du lycée d’accueil des aménagements nécessaires.
-
PAP (plan d’accompagnement personnalisé) ou PAI (projet d’accueil individualisé) : poursuivis à l’identique au lycée sauf si les besoins évoluent. Si les troubles ou la maladie surviennent au cours de la scolarité, un PAP ou un PAI peuvent être mis en place.
-
Temps aménagés : emploi du temps allégé, temps de repos, repérage clair des lieux.
-
Adaptations pédagogiques : supports visuels, consignes claires, temps supplémentaire.
-
Accompagnement humain (AESH), toujours envisageable à cette étape de la scolarité (à demander auprès de la MDPH).
-
Espaces de retrait ou de calme accessibles en cas de surcharge sensorielle.
-
Suivi médico-social : séances au lycée, à domicile ou en cabinet (SESSAD, IME…).
D. Ulis, autorégulation, médico-social : quels sont les dispositifs spécifiques ?
Des dispositifs renforcés existent, à la fois au sein du lycée ou en partenariat avec un établissement médico-social :
-
ULIS-lycée : unité localisée pour l’inclusion scolaire, avec un enseignant spécialisé et un cadre de travail adapté, lorsque les exigences d’une scolarisation individuelle ne sont pas compatibles avec les besoins spécifiques du lycéen.
-
Autorégulation : dispositif favorisant, notamment, l’intégration des élèves présentant un TND dans les classes ordinaires, tout en proposant un espace dédié encadré par des professionnels du médico-social. Objectif : apprendre à maîtriser ses émotions, devenir plus autonome et gagner en confiance.
Attention : l’autorégulation n’est encore pas développée sur tous les cycles de scolarisation selon les départements.
-
Établissement médico-social (EMS) : scolarisation possible dans l’unité d’enseignement d’un EMS, avec soins, rééducations et formation professionnelle.
-
SESSAD : la scolarité en primaire comme en collège ou lycée, peut également s’effectuer avec l’appui d’équipes SESSAD (service d’éducation spécialisée et de soins à domicile) qui apporte un soutien spécialisé aux enfants et adolescents handicapés dans leur milieu ordinaire de vie et d’éducation ainsi qu’à leurs familles. Il est également destiné à favoriser la montée en compétence des équipes pédagogiques et à maintenir la place de la personne en milieu inclusif.
E. Aménagements d’épreuves du baccalauréat
Le lycéen concerné par un trouble du neurodéveloppement peut demander plusieurs types d’aménagements, combinables et cumulables entre eux :
- temps supplémentaire ;
- adaptation d’épreuve ;
- aide d’un preneur de notes ou assistance de l’AESH ;
- utilisation de matériel adapté ;
- possibilité de composer dans une salle à part.
Les candidats peuvent demander la conservation pendant 5 ans des notes de leur choix.
Les aménagements accordés doivent être cohérents avec ceux mis en place pendant l’année.
Pour bénéficier de ces démarches, validées par le recteur de l’académie, il convient de renseigner un dossier, complété par l’avis du médecin scolaire ou un médecin désigné par la MDPH.
https://cache.media.education.gouv.fr/file/14/64/5/enselsup112_annexe3_1425645.pdf
Chaque académie publie un calendrier spécifique à l’automne.
Pour en savoir plus :
- N° vert unique Information école inclusive : 0 805 805 110
Pour les personnes sourdes ou malentendantes : composer le 0 800 730 123 du lundi au vendredi de 9h à 17h
- Réussir au lycée, Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse
- Baccalauréat, Service-public.fr
- Adaptations et dispenses au baccalauréat général et technologique sur Eduscol
- Guide d’accompagnement du lycéen avec troubles du spectre de l’autisme, académie de Strasbourg
2. Le lycée professionnel
Les lycées professionnels, également appelés « lycées des métiers », accueillent de plus en plus d’élèves autistes ou avec d’autres TND pour les accompagner vers un parcours de formation qualifiant. Le bac pro offre une qualification reconnue sur le marché du travail.
Le lycée professionnel dispense :
- des enseignements généraux : français, mathématiques, histoire-géographie, sciences, anglais ;
- des enseignements en atelier, laboratoire ou chantier selon l’orientation.
Il prépare à un CAP, BEP, bac pro ou BTS. Il existe 200 spécialités en France.
A. Quelles sont les spécificités du lycée professionnel ?
Il dispense les disciplines d’enseignement général (français, mathématiques, histoire-géographie, sciences, anglais). A cela s’ajoutent des cours en atelier, en laboratoire ou en chantier selon les choix d’orientation.
Le lycée professionnel prépare à un CAP, un BEP, un bac pro, voire un BTS, dans des domaines variés (restauration, bâtiment, coiffure, industrie, services…). Il existe 200 spécialités en France.
Pour les élèves avec TND, cela permet de :
- développer des compétences pratiques
- se former en situation réelle (ateliers, stages)
- travailler sur la socialisation dans un cadre encadré
- envisager un accès à l’emploi ou à des études supérieures adaptées.
B. Aménagements pour un lycéen avec autisme, TDAH, dys, Tourette…
Les aménagements pédagogiques et organisationnels peuvent être mis en place, identiques à ceux proposés en lycée général (voir plus haut Lycée général, question 2).
Mais certains dispositifs renforcés sont néanmoins spécifiques à la filière pro :
- Préparation anticipée des stages : repérage des lieux, médiation avec l’entreprise…
- Ulis-lycée professionnel : inclusion en classe/atelier et accompagnement individualisé. (En savoir plus sur l’Ulis-lycée : voir paragraphe Ulis Lycée ci-dessous).
- Stages en milieu protégé : avec le concours de structures comme les ESAT (établissements et services d’aide par le travail) ou EA (entreprises adaptées).
Lors du passage du bac pro, la liste des aménagements est identique à celle proposée en lycée général (voir plus haut). Néanmoins un formulaire dédié au bac pro doit être complété.
C. Particularités du bac professionnel
Ce baccalauréat se prépare pendant 3 ans après la 3e.
Le diplôme permet d’accéder directement à un emploi ou de poursuivre sa formation dans l’enseignement supérieur, principalement en première année de BTS.
Dans cette optique, la classe de seconde pro est organisée en familles de métiers pour favoriser une spécialisation progressive jusqu’à la terminale pro.
Sous statut scolaire ou en apprentissage, il est aussi accessible après un CAP ou un autre bac. Il peut déboucher sur :
- un brevet de technicien supérieur (BTS),
- un CAP (pendant 2 ans) afin de se préparer à un métier précis (200 spécialités)
- ou l’accès à un CFA (centre de formation des apprentis) –> l’élève n’a alors plus le statut d’étudiant mais continue néanmoins à se former après le collège (voir cette fiche).
Pour en savoir plus :
- Baccalauréat professionnel, Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse
A retenir
- Les « lycées des métiers », accueillent de plus en plus d’élèves autistes ou avec TND.
- Ils leur offrent des parcours de formation qualifiant dans plus de 200 spécialités via un CAP, un BEP, un bac pro, voire un BTS.
- Des aménagements pédagogiques et organisationnels peuvent être mis en place, durant l’année scolaire (incluant un suivi lors des stages en entreprise), ainsi que lors des examens du baccalauréat.
- Il existe des Ulis-lycée professionnel, dispositif avec un enseignant spécialisé, qui permet d’articuler inclusion en classe/atelier et accompagnement individualisé.
3. ULIS-lycée
Le dispositif Ulis-lycée est dédié aux élèves avec des difficultés persistantes en termes d’autonomie et d’apprentissages.
L’objectif ? Leur permettre d’être scolarisés dans leur classe d’âge et de bénéficier de l’expertise du professeur-coordonnateur spécialisé en petit groupe.
A. Qu’est-ce qu’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis)-lycée ?
Encadré par un enseignant spécialisé, le lycéen est scolarisé dans sa classe de référence, avec, en complément, des temps de travail en groupe restreint pour les matières dans lesquelles il a des difficultés, avec la présence d’un AESH partagé.
Dix élèves maximum sont accueillis mais l’inspecteur d’académie peut décider de limiter l’effectif à un nombre sensiblement inférieur en fonction du projet pédagogique.
Les Ulis accueillent des élèves ayant des besoins similaires, mais pas obligatoirement le même type de handicap. Certaines Ulis, très minoritaires, sont spécifiquement dédiées aux élèves avec un TSA et sont nommées « Ulis TSA ».
B. Dans quels types d’établissements sont implantées les Ulis-lycée ?
Moins nombreux qu’au collège, les dispositifs Ulis existent en lycée général et technologique pour préparer un diplôme ou son entrée en enseignement supérieur.
Mais elles sont surtout proposées en lycée professionnel (Ulis-LP) ou agricole, pour suivre un CAP ou une formation en vue d’une insertion professionnelle (il existe également quelques Ulis-pro TSA).
L’adolescent s’y perfectionne dans les disciplines générales, tout en s’initiant aux techniques professionnelles et en se confrontant aux réalités du terrain lors des stages.
Les Ulis en lycée professionnel sont fréquemment organisées en réseau avec d’autres établissements, multipliant ainsi les possibilités de découverte des secteurs professionnels. La durée du parcours de formation est aménagée et variable, de 2 à 4 ans selon le niveau et le projet de l’élève.
Les modalités de fonctionnement des Ulis dans les lycées professionnels sont précisées dans une circulaire sur la formation et l’insertion professionnelle des élèves en situation de handicap.
À savoir : Les élèves d’Ulis sortant de formation sans diplôme peuvent recevoir une ou plusieurs attestations de compétences professionnelles , leur permettant poursuivre, selon leurs capacités, la préparation d’un diplôme.
C. Comment être orienté en Ulis-Lycée ?
C’est la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) de la MDPH qui notifie l’orientation en Ulis-lycée dans le cadre du PPS (projet personnalisé de scolarisation).
C’est ensuite le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) qui affecte les élèves en fonction de leurs besoins, du secteur et des places disponibles.
À savoir : si la décision d’orienter leur enfant en Ulis ne convient pas à la famille, elle peut la refuser. Le jeune reste alors scolarisé dans son lycée (ou école ou collège) de référence en attendant une réévaluation avec la notification des aménagements souhaités.
D. Quelles sont les missions de l’enseignant spécialisé ?
L’enseignant spécialisé-coordonnateur de l’Ulis est en charge de l’enseignement mais aussi de :
- appuyer le jeune dans ses apprentissages généraux et professionnels
- assurer un suivi de son projet d’orientation, accompagner dans son projet de poursuite d’études et préparer son entrée dans l’enseignement supérieur.
- suivre ses périodes de formation en milieu professionnel avec le professeur chargé de l’évaluation des compétences professionnelles (PFMP) ainsi qu’avec le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT)
- suivre les aménagements et les adaptations nécessaires, en milieu scolaire comme en entreprise
- fournir un accompagnement à l’insertion professionnelle via un partenariat avec France Travail – Cap Emploi, mission locale, dispositifs académiques d’insertion professionnelle, associations d’accompagnement vers l’emploi…
C’est aussi lui qui organise des réunions de l’Équipe de suivi de scolarisation (ESS) pour adapter le PPS et le parcours du jeune.
E. Où trouver une Ulis-lycée en France ?
Attention, il n’y a pas forcément une Ulis dans chaque établissement. Les unités sont pour la plupart organisées en réseau sur plusieurs lycées proches géographiquement afin de diversifier le choix des formations.
Si l’Ulis se trouve trop éloignée du domicile, il existe sous certaines conditions des prises en charge du transport par un véhicule professionnalisé.
L’enseignant référent ou encore le service départemental de l’École inclusive de la DSDEN de chaque département et la DRAAF (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) pour les lycées agricoles sont en mesure de renseigner les familles.
Pour en savoir plus :
- Qu’est-ce qu’une Ulis ? (Mon parcours handicap)
- Ulis dans le premier et second degré (BO de l’Éducation nationale)
A retenir
- Encadré par un enseignant spécialisé, le lycéen est scolarisé dans sa classe de référence, avec, en complément, des temps de travail en groupe restreint pour les matières dans lesquelles il a des difficultés.
- Cette unité compte dix élèves maximum, permettant un accompagnement individualisé.
- Les Ulis présentes dans lycées généraux et technologiques sont néanmoins plus nombreuses en lycées professionnels.
- Il n’y a pas forcément une Ulis dans chaque établissement ; elles sont alors organisées en réseaux sur plusieurs lycées proches.
- L’orientation se fait sur notification de la CDAPH.
5. Autorégulation
L’autorégulation est un accompagnement visant à soutenir l’autonomie de l’élève avec TND et à consolider ses apprentissages. Le lycéen est scolarisé dans sa classe ordinaire, avec, en cas de besoin, des temps autorégulation personnalisés dans un espace dédié, encadrés par un enseignant spécialisé et des professionnels du médico-social.
A. Qu’est-ce que l’autorégulation ?
Il s’agit d’un dispositif scolaire qui vise à favoriser l’intégration des élèves présentant un TND (trouble du neurodéveloppement) du primaire au lycée, tout en leur apprenant à maîtriser leurs émotions et leurs comportements, à devenir plus autonomes et à gagner en confiance dans les apprentissages.
Le lycéen est inscrit dans une classe ordinaire, avec des camarades de même âge, mais bénéficie d’un enseignement « d’autorégulation ».
Quand il en ressent le besoin, il rejoint un espace spécifique et sécurisant situé au sein de l’établissement pour des accompagnements ponctuels (individuels ou en petits groupes) avec des éducateurs spécialisés ou d’autres professionnels du médico-social (psychologue, rééducateurs…).
Dès qu’il se sent prêt, il rejoint sa classe, seul ou accompagné par un éducateur spécialisé.
B. Quel bénéfice pour les lycéens ?
Depuis la rentrée 2024, l’autorégulation est déployée dans les collèges et lycées pour les élèves qui ont besoin d’un soutien spécifique et notamment ceux avec TND, en évolution des dispositifs initialement spécialisés « TSA ». Elle concerne désormais les jeunes ayant n’importe quel trouble du neurodéveloppement.
A la rentrée 2025, une équipe d’autorégulation est mise en place pour la première fois au sein d’un lycée agricole.
L’autorégulation au lycée est accessible quelle que soit la modalité de scolarisation précédente, y compris dans le cas d’une rupture de parcours qui nécessite une attention particulière de la part de l’équipe pédagogique du lycée et de l’équipe pluriprofessionnelle d’autorégulation. Le cahier des charges indique cependant que le jeune doit avoir le niveau du cycle dans lequel il est inscrit.
L’autorégulation est organisée au sein de l’établissement scolaire mais également dans tout environnement professionnel : stages en entreprise (stages des élèves de 2nde GT, de la série sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration ou STHR), sur les lieux d’apprentissage puis, à terme, en milieu ordinaire ou adapté.
C. Qui sont les intervenants dédiés à l’autorégulation ?
Une équipe pluridisciplinaire (enseignant, éducateurs spécialisés, psychologue, psychomotriciens, personnels médico-sociaux).
Elle tient compte des difficultés socio-communicationnelles du jeune, de ses rigidités, ses spécificités sensorielles et également de sa fatigabilité.
Des interventions thérapeutiques, en lien avec le projet personnalisé de scolarisation, peuvent également être proposées.
L’équipe aide également les enseignants des classes à rendre leur enseignement accessible à tous et à diffuser les principes de l’autorégulation dans l’ensemble de l’établissement scolaire.
Elle soutient entre sept et dix élèves avec TND, mais son expertise bénéficie à toute la communauté éducative.
D. Comment être orienté vers l’autorégulation ?
Tous les élèves avec TSA peuvent bénéficier d’une approche fondée sur le principe de l’autorégulation dès lors qu’ils bénéficient d’une orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Cette notification indique le mode de scolarisation, et en même temps, l’orientation vers le service médico-social ayant conventionné avec l’école.
Cette orientation s’envisage sur la durée d’un cycle scolaire (de la seconde à la terminale pour le lycée) mais peut être revue à la demande de la famille qui doit, pour cela, saisir la MDPH.
La famille procède à l’inscription de l’enfant auprès des services de la mairie de la commune où se trouve l’école désignée par l’inspecteur d’académie (IA), directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen).
L’accueil de l’enfant dans le dispositif s’effectue simultanément par le directeur de l’école qui inscrit l’élève et par le directeur de l’établissement ou service médico-social qui prononce son admission dans le service.
Pour en savoir plus :
- Autorégulation au lycée (cahier des charges)
- Vidéo explicative
- Téléchargez la fiche pratique « Qu’est-ce que l’autorégulation ? » Handicap.gouv.fr (présentation du dispositif + vidéos explicatives)
A retenir
- L’autorégulation est un accompagnement individualisé du lycéen avec TND qui vise à soutenir son autonomie et consolider ses apprentissages.
- Depuis la rentrée 2024, ce dispositif est ouvert aux collèges et lycées.
- Le jeune est scolarisé dans sa classe ordinaire à temps plein avec des moments dans un espace dédié calme et sécurisant.
- Il est encadré par un enseignant dûment formé et des professionnels du médico-social, par exemple psychologue ou éducateur.
- L’orientation se fait sur notification de la CDAPH.
À savoir
Les dispositifs et aménagements présentés dans cette fiche s’inscrivent pleinement dans les objectifs de la Stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027, qui vise à renforcer l’inclusion scolaire et la continuité des parcours des enfants, adolescents et jeunes adultes avec TND.
Cette stratégie prévoit notamment :
- l’amélioration de l’accompagnement scolaire, grâce à une meilleure identification des besoins, la diffusion d’outils adaptés et la formation des professionnels de l’Éducation nationale ;
- le développement de dispositifs inclusifs, tels que les ULIS, les dispositifs d’autorégulation ou les services médico-sociaux intervenant en milieu ordinaire ;
- la sécurisation des transitions éducatives, notamment entre le collège, le lycée et l’enseignement supérieur ou professionnel ;
- la montée en compétence des équipes pédagogiques et médico-sociales, afin de garantir un environnement scolaire accessible, structuré et adapté aux profils cognitifs et sensoriels des élèves avec TND ;
- le renforcement de la coopération entre les acteurs de l’école et du médico-social, pour assurer un suivi coordonné et adapté tout au long de la scolarité.
Découvrez les fiches en lien avec ce thème
Ces contenus pourraient vous intéresser
- Sante.gouv.fr : Définition, fonctionnement & différentes formes de l’autisme
- Handicap.gouv.fr – Les troubles du neurodéveloppement
- Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux communément appelé DSM (publié en 2013, disponible en français depuis 2015 dans sa cinquième version : DSM-5), section « Troubles neurodéveloppementaux »
- Classification Internationale des Maladies 11e révision (CIM-11) entrée en vigueur en 2022, section « Troubles neurodéveloppementaux »